Je découvre les éditions Drakoo à travers ce "one-shot". La maison d'édition, dédiée aux mondes de l'imaginaire, est dirigée par Christophe Arleston, ancien rédacteur en chef de Lanfeust Mag.
Le sarcophage des âmes s'inscrit dans le genre horrifique et les références aux sorcières de Salem sont impossibles à ignorer. On les trouve, par exemple dans les toponymes : Shaalem et Brostown. En revanche, un glissement dans le cadre chronologique nous conduit près de 300 ans après le fameux procès en sorcellerie, soit à la fin du 19ème siècle. Le choix de l’ère victorienne reste propice à un récit empreint d’ésotérisme et permet d’introduire une pointe de vaudouisme grâce au personnage d’Olivia Newton, descendante d’esclaves. Cette jeune veuve, qui souhaite réaliser des fouilles archéologiques dans le cimetière, ne fait pas l’unanimité dans le comté. Un soir d’hiver, le fossoyeur convainc un groupe d’individus alcoolisés de forcer la porte d’Olivia et d’incendier sa maison. Abbie, son amie, parvient à s’échapper de justesse. Elle entraîne avec elle Mercy, la fille d’Olivia. Le juge Taylor, informé des évènements, décide de confier la fillette à sa propre femme et de clore l’affaire sans investigations complémentaires. Quelques jours plus tard, Olivia Newton réapparait miraculeusement. Elle a deux idées en tête : récupérer son enfant et exhumer les reliques d’un puissant nécromancien avant que les adeptes du mal ne s’en emparent.
Serge Le Tendre, le scénariste de cet album, entraîne son lecteur dans une intrigue particulièrement haletante au risque de s’essouffler un peu. Pour ma part, je refermé la bande dessinée avec un léger sentiment de frustration. Quelques pages supplémentaires n’auraient pas nui au récit. Ce rythme effréné se retrouve dans les planches de Patrick Boutin-Gagné qui multiplie les cases étroites. Ses personnages ont souvent des traits acérés ou brouillés, selon les circonstances et l’intention du dessinateur.
La fin de l’album suggère qu’une suite est envisageable, transformant ce one shot en série avec ses personnages récurrents. Il me semble en effet que les protagonistes principaux pourraient être développés. En ce qui me concerne, je me suis beaucoup interrogée sur leur passé. Qui était vraiment le mari défunt d’Olivia ? Comment Abbie est-elle devenue une macrelle à la tête d'une maison close ? Dans quelle circonstance a-t-elle rencontré le colossal Hugo, son garde du corps ? J’espère trouver les réponses à ces questions dans de prochains épisodes.
📌Le sarcophage des âmes. Serge Le Tendre (Scénariste) & Patrick Boutin-Gagné (Illustrateur). Drakoo, 48 pages (2022)






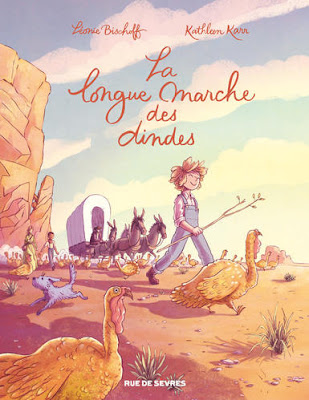


















%20Film%20Don%20Siegel.jpg)




