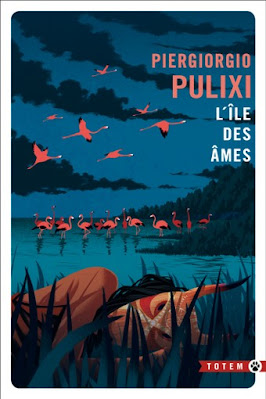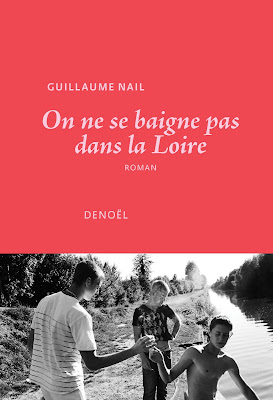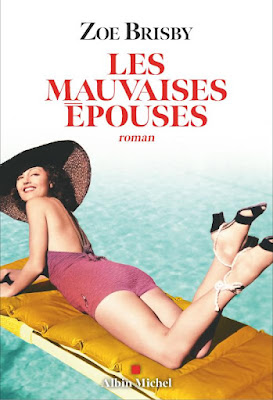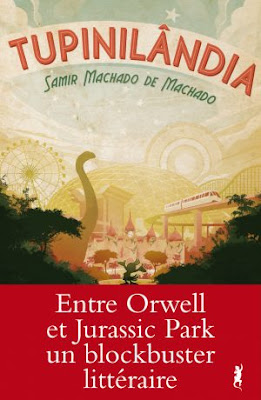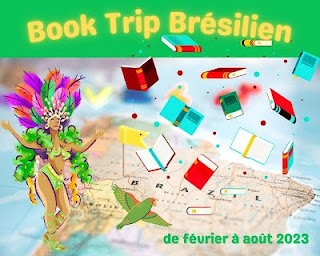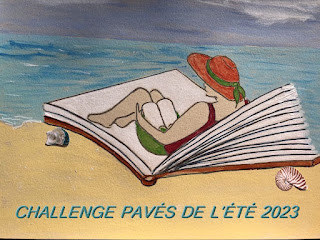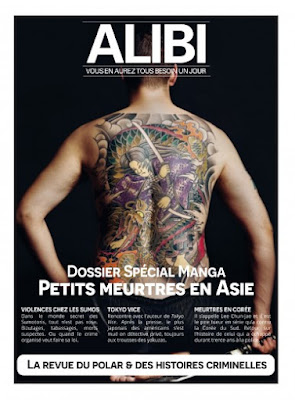Après le vaste territoire américain, la maison Gallmeister invitent ses lecteurs à s’évader vers de nouveaux horizons. C’est ainsi que le romancier italien, d’origine sarde, Piergiorgio Pulixi, est entré dans son catalogue en 2021. L’île aux âmes, son premier titre traduit en Français, nous conduit donc en Sardaigne où les paysages splendides et la douceur automnale ne nous ferons pas oublier l’atmosphère alourdie par des crimes rituels particulièrement sanglants.
Un duo improbable, formé par deux enquêtrices récemment mutées au service des affaires classées de Cagliari (en réalité un placard où elles doivent expier leurs fautes), est chargé d’enquêter sur un dossier exhumé par leur collègue Moreno Barrali (lui-même en arrêt maladie). Il s’agit de deux meurtres rituels remontant à 1975 et 1986. Barrali est persuadé que ces cold cases ont un lien avec l’enlèvement d’une jeune femme quelques jours plus tôt. Il s’agit de Dolores Murgia, 22 ans. Elle était liée à une secte, adepte de cultes nuragiques. Tandis que Mara Rais et Eva Croce explorent cette piste, le romancier attire notre attention sur une famille vivant quasiment en autarcie dans les montagnes de la Barbagia. Le doyen veille à perpétuer les traditions ancestrales de cette société agropastorale, aidé par son petit-fils, Bastianu Ladu, qui n’est pas sans rappeler les chefs de clan mafieux.
Ce premier volet de la série (le second épisode, intitulé L'Illusion du mal, est paru en France en 2022) tient tout à fait ses promesses. Le dépaysement est total et le lecteur se laisse volontiers porter par l’intrigue de cet "ethno polar" singulier. Si le roman est riche d’informations culturelles et anthropologiques, l’enquête policière n’est pas reléguée au second plan comme cela arrive trop souvent dans ce genre de romans policiers. Les enquêtrices mènent leur affaire tambour battant, dans une ambiance sans doute pesante pour elles mais absolument jouissive pour le lecteur (j’ai adoré les joutes verbales entre la Sarde et la Milanaise).
La bonne nouvelle, c’est que les éditions Gallmeister publient un nouveau livre de Piergiorgio Pulixi, Le Chant des innocents, à la fin du mois.
📚D’autres avis que le mien chez Athalie, Dasola et Sandrine
💪Challenge des Pavés de l’été chez La petite liste
📌L'île des âmes. Piergiorgio Pulixi. Totem/Gallmeister, 560 pages (2022)