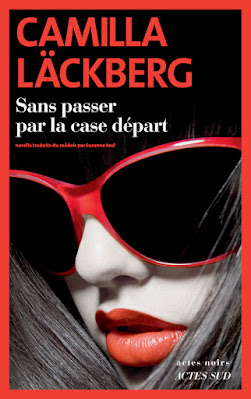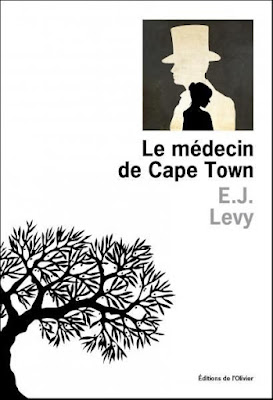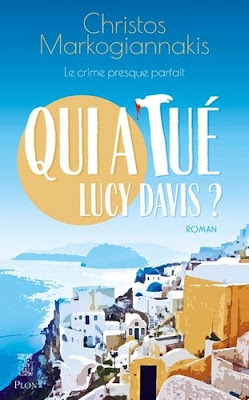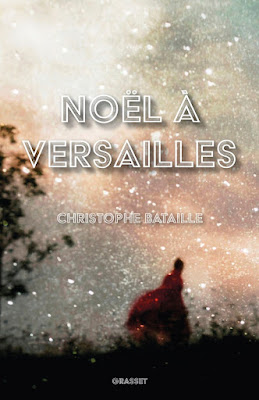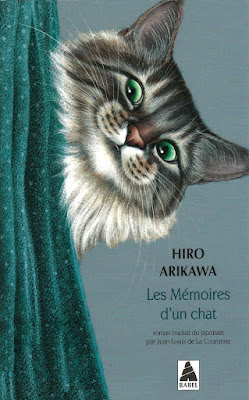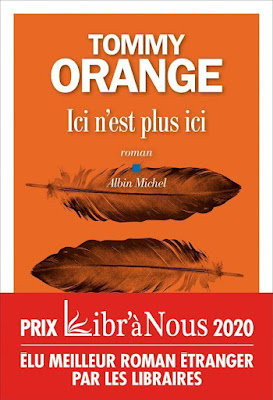« La maison s’élève sur trois étages. C’est l’une des plus grandes et luxueuses de Skuru. Au rez-de-chaussée, une gigantesque pièce avec vue sur les eaux sombres du détroit. C’est ici qu’ils vont réveillonner. Une partie de la pièce est aménagée en cuisine avec un énorme îlot central et une table pour au moins douze convives, tandis que l’autre partie est dotée de deux volumineux canapés Svenskt Tenn recouverts d’une étoffe au design si caractéristique de Josef Frank. Décorée de meubles estampillés parmi les plus prestigieux, ainsi que d’antiquités à faire verdir de jalousie l’hôtel des ventes Bukowskis, cette immense salle est de toute évidence destinée à impressionner les convives. »
C’est le soir de la Saint-Sylvestre. Un groupe de jeune nantis se réunit dans une villa de Skurusundet, un détroit dans l’archipel de Stockholm accueillant le quartier le plus huppé de la capitale suédoise. Leurs parents font la fête juste en face, dans une demeure tout aussi somptueuse. Ils sont quatre (deux filles et deux garçons) et se connaissent depuis l’enfance. Ils préfèrent rester entre eux, dans leur microcosme de lycéens blasés et nombrilistes. En réalité, cette jeunesse dorée est très abîmée et s’anesthésie dans tous les excès. Liv, la première arrivée sur place, exhume un jeu de Monopoly. Quelqu’un, peut-être son copain Max (l’inévitable bellâtre du clan), suggère de modifier les règles du jeu pour pimenter la soirée. Martina, sa petite-amie instagrameuse, et Anton, son faire-valoir, sont de la partie. On flirte, on s’enivre, on s’envoie des vacheries à la figure, on se console dans les vapeurs d’alcool, on commence à vandaliser les lieux… et le lecteur a compris depuis longtemps qu’un drame va se produire. Les secrets les plus sordides vont être révélés et les blessures exiger réparation.
J’ai lu beaucoup de polars de Camilla Läckberg (presque toute la série des Erica Falck) sans jamais être déçue. Il fallait bien une exception. La romancière scandinave veut nous dire qu’il faut aller au-delà des apparences mais le trait est trop forcé pour être crédible. Au lieu de personnages complexes, elle brosse des portraits caricaturaux. Je n’ai pas éprouvé beaucoup d’empathie pour ses jeunes gens arrogants même lorsque les masques sont tombés. Et leurs géniteurs sont encore pires évidemment. Dans la série des clichés, ce livre permet au moins d’en dénoncer un : En suède, il n’y a pas qu’une seule marque de meubles.
Cette novella, d’abord parue indépendamment, a été rééditée avec une autre nouvelle (Femmes sans merci) dans un recueil intitulé Petites Histoires cruelles (Actes Sud, 2023).
📚D'autres avis que le mien via Babelio et Bibliosurf
📌Sans passer par la case départ. Camilla Läckberg, traduit par Susanne Juul. Actes Sud, 112 pages (2021)