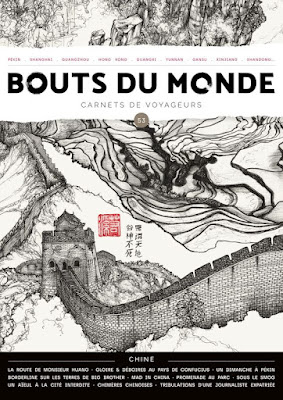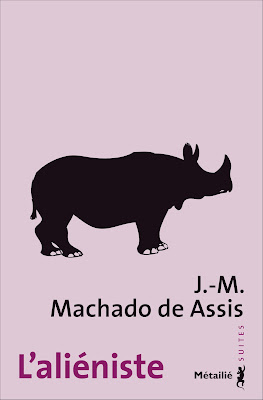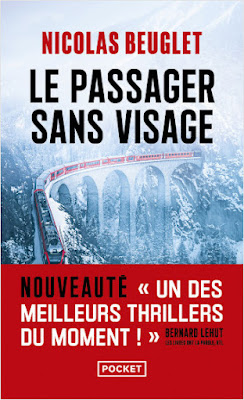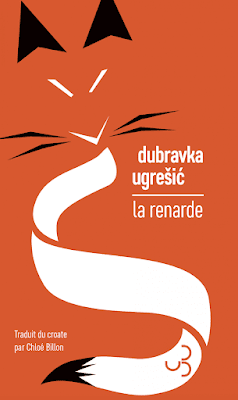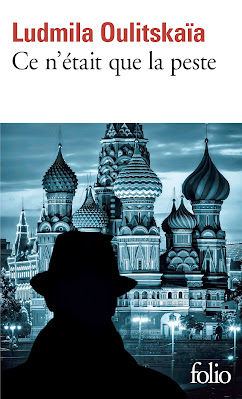On ne sait pas grand-chose de l’écrivain qui se cache derrière le pseudonyme de Koz, si ce n’est qu’il s’intéresse beaucoup aux différents maux qui frappent notre monde contemporain. Ils sont d’ailleurs l’objet du triptyque constitué par Noir (Pocket, 2022), Rouge (Pocket, 2022) et Bleu (Fleuve noir, 2022), trois "polars apocalyptiques" parus à quelques mois d’intervalle. Les héros récurrents de cette série sont amenés à enquêter sur des actes de terrorisme dans des contextes très particuliers de catastrophes naturelles ou technologiques.
Dans le premier volet de la série, la région parisienne était plongée dans un black-out meurtrier provoqué par l’explosion simultanée des dix-huit transformateurs alimentant le réseau. Le second tome s’inspire des périodes de canicule et des incendies qui ont ravagés le sud de la France. Ici, les feux ont évidemment été allumés par une main criminelle. Dans Bleu, enfin, le dérèglement climatique est à l’origine d’une violente tempête, combinée à un phénomène de grande marée d’équinoxe. La ville de Nantes est submergée par les eaux tandis qu’une vague de suicides sans précédent alerte les services hospitaliers et un certain Fabrice Le Troadec, représentant de la police locale. Il est rapidement rejoint par le groupe de la cellule Nouvelles Menaces, dirigé conjointement par Hugo Kezer et Anne Gilardini. L’inondation de la cité ne facilite pas la tâche des flics. Néanmoins, ils comprennent qu’il s’agit d’une attaque bactériologique et qu’un virus foudroyant se propage via le système de canalisations métropolitain.
En lisant le résumé en quatrième de couverture, j’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’un roman d’anticipation. En réalité, il s’agit bien d’un polar, même si le lecteur est rapidement plongé dans une ambiance type film catastrophe. De fait, les évènements et les rebondissements s’enchaînent à une vitesse vertigineuse. On comprend, bien sûr, que le temps est compté pour les enquêteurs puisqu’une nouvelle pandémie menace le monde, leurs actions étant limitées par la contrainte de la crue exceptionnelle et de la nécessité d’évacuer la population, y compris les techniciens scientifiques.
Comme dans la plupart des séries policières, les protagonistes principaux, à savoir les flics, traîne avec eux un lourd passé qui plombe leurs humeurs et conditionne leurs prises de décision respectives. Pour ma part, j’ai été un peu trop bousculée pour avoir le temps de m’attacher et de compatir vraiment. Mais c’est peut-être aussi lié au fait que je n’ai pas lu les précédents épisodes de la série. Pour le reste, on sent que l’écrivain a fait des recherches poussées sur le système de dépollution et de distribution des eaux de la métropole nantaise, les différents services de police et les structures de recherche en virologie. L’intrigue et le récit sont d’autant plus réalistes. Bleu est ce qu’on appelle un "Page Turner", un roman qui se lit avec avidité et qu’on a du mal à lâcher avant la fin.
📌Bleu. Koz. Fleuve Noir, 320 pages (2022)