
Voici un livre dans l’air du temps qui ne devrait pas plaire qu’aux seuls amoureux des chats. Il enchantera les geeks, les lecteurs de mangas, les amateurs d’animes et, en particuliers, ceux produits par les studios Ghibli… bref, comme l’indique le titre, il est le reflet de la culture mainstream. Néanmoins, l’ouvrage va un peu au-delà du champ d’étude de la culture populaire puisqu’il aborde d’autres aspects comme la mythologie, la science et les arts académiques.
Les humains sont-ils parvenus à domestiquer le chat ou juste à l’apprivoiser ? A moins que cela ne soit le contraire. Sommes-nous en réalité les esclaves de nos matous ? Difficile de répondre à cette question avec certitude. Quoi qu’il en soit, le petit félin nous fascine depuis la nuit des temps… en fait depuis le néolithique, période à laquelle l’Homme et l’animal ont commencé à se côtoyer. Depuis, nous vivons une histoire commune pour le moins mouvementée.
Déifié par la civilisation égyptienne antique puis martyrisé dans l’occident médiéval, le chat fut d’abord considéré comme un Yokaï (démon) au Japon puis comme une muse chez les artistes européens des 19ème et 20ème siècle, avant d’être envoyé dans l’espace par les scientifiques français. Aujourd’hui, le petit félin est omniprésent dans notre vie quotidienne et dans les médias. On le trouve dans nos livres et sur nos écrans. Au Pays du Soleil Levant, il possède même ses temples dédiés et plusieurs Nekojima (îles aux chats).
Les chats dans la pop culture est une mine d’informations. Le livre de Stéphanie Chaptal et Claire-France Thevenon est divisé en huit parties (Le chat vs les autres animaux, Le chat incarnation du bien ou du mal, Le chat mystique, etc).
Le chat est présenté tour à tour dans son rôle de protagoniste ou d’antagoniste et comme ressort humoristique. On pense, par exemple, à Sylvestre dans Titi et Grosminet, à Hercule dans Pif Gadget ou à Tom et Jerry, pour ne citer que les plus connus. Notre tendance à l’anthropomorphisme nous incite à attribuer un certain nombre de qualités et défauts à nos compagnons. De fait, le chat est souvent présenté comme paresseux, gourmand, voleur voire hâbleur. Garfield, le héros de Jim Davis, l’un des matous le plus célèbres de la bande-dessinée, n’est-il pas gourmand, obèse et spécialement égocentrique?
Néanmoins, le chat est avant tout un objet de fascination pour les humains qui ont tant de mal à le comprendre. C’est ainsi qu’on lui a attribué un grand nombre de pouvoirs ou associé à des êtres surnaturels, parfois considérés comme maléfiques. On pense aux chats noirs qui accompagnent souvent les sorcières dans l’imaginaire populaire. Dans la série des Harry Potter, les félins sont à l’image de leurs maîtres respectifs (cf Pattenrond, le chat d’Hermione ou Miss Teigne, la chatte du concierge de Poudlard). Dans la littérature de genre, le chat se fait psychopompe ou carrément démoniaque : rappelez-vous Simetierre de Stephen King !

D’aucuns ont tendance à penser que les matous entretiennent des liens particuliers avec les femmes. Ils accompagnent les sorcières, bonnes ou mauvaises (Jiji, le chat de Kiki la petite sorcière) mais pas seulement. Parmi les préjugés les plus courants, on peut mentionner l’archétype de la « mémère à chats», la vieille fille frustrée et dépressive atteinte du syndrome de Noé (pathologie qui consiste à adopter plus d’animaux que de raison). A l’inverse, la femme féline est considérée comme une femme racée et indépendante. Catwoman, l’héroïne de DC Comics en est l’un des symboles.
Il serait fastidieux de rapporter dans ce compte-rendu de lecture toutes les entrées envisagées par les auteurs dans cet ouvrage exhaustif. Cependant, parmi les tendances observées récemment, on distingue un courant largement véhiculé par la japonisation de la culture, relayé par l’imaginaire occidental : le chat Kawaï (mignon) associé au phénomène « Lolcat » (mèmes amusants avec des chats). On peut mentionner Nyan Cat, le chat au corps en forme de « Pop-Tart » (tartelette plate) dessiné par Chris Torrès en 2011. Le gif est ensuite diffusé sur Youtube par Sara June, accompagné d’une musique electro-pop japonaise, appelé Nyanyanyanyanyanyanya! en référence à l'onomatopée nippone du miaulement. Enfin, parmi les icônes du Kawaï, on peut citer Hello Kitty (mascotte crée par la société japonaise Sanrio en 1974 et qui a produit de nombreux dérivés), ainsi que Grumpy Cat (une petite chatte devenue célèbre via Instagram).

Le livre de Stéphanie Chaptal et Claire-France Thevenon est bien documenté et propose une riche iconographie. Je n’ai pas compté leur nombre exact, mais les auteurs présentent plusieurs dizaines d’œuvres de références, piochées dans la littérature, la bande-dessinée, le cinéma, la peinture, la publicité, etc. La présentation de l’ouvrage a l’avantage d’être très claire. Chaque félin cité dans le livre possède sa fiche d’identité, mentionnant son nom, sa date de naissance, ses géniteurs et son C.V. (les œuvres dans lesquelles il apparait). A la fin de l’ouvrage, il y a même un petit glossaire pour les néophytes. Si je devais chipoter, je dirais qu’il manque peut-être un index des œuvres mentionnées.
📝 Bibliographie consacrée au Chat dans la littérature japonaise ici
📌Les chats dans la pop culture. Stéphanie Chaptal et Claire-France Thevenon. Ynnis, 205 p. (2021)
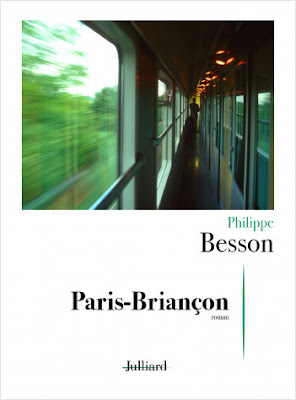

























.jpg)










