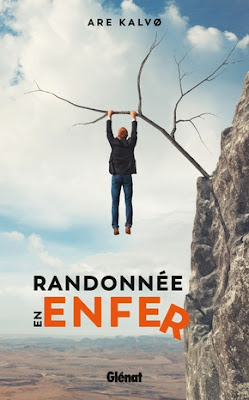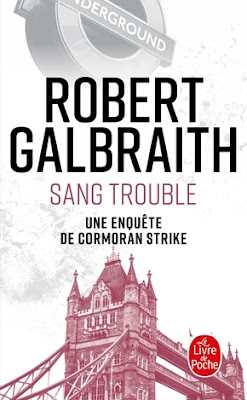Si le titre de ce livre fait plutôt penser à un thriller, sachez qu’il s’agit en fait d’un récit de voyage dédié aux citadins qui ne sont pas vraiment fans de randonnée, de montagne ou de sport outdoor. Oui, le concept à de quoi surprendre mais Are Kalvø est un écrivain facétieux qui adore écrire sur ce qu’il ne connait pas voire ce qu’il ne comprend pas. Le but de cette expérience est justement de découvrir pourquoi la majorité de ses proches décident, à la quarantaine, de déserter la ville et les lieux de convivialité pour aller marcher dans la nature, si possible le plus loin possible de l’humanité. A ce stade, l’auteur établit un lien (douteux, certes) de cause à effet, entre le fait de s’enticher des sports d’extérieur et celui de perdre ses cheveux ainsi que son sens de l’humour.
L’humoriste norvégien décide donc de se lancer dans une surprenante quête qui va le conduire à tenter lui-même l’expérience de la randonnée en montagne. A ce sujet, il me semble que le titre devrait être au pluriel puisqu’il entreprend deux voyages à plusieurs mois d’intervalle : l’un en été dans le Jotunheimen; l’autre, en hiver au Hardangervida. Le but, explique-t-il à sa compagne, est de découvrir, à l’instar de ses amis, le plaisir de se faire photographier torse-nu au sommet d’une montagne, les bras ouverts vers le ciel. Celle-ci est d’ailleurs recrutée sans délai et nommée responsable de la documentation. Dans les faits, elle est plus ou moins chargée de la logistique et de remonter le moral des troupes dans les moments de doute. Un couple de fêtard vient compléter l’équipe lors du séjour sur le plateau des Alpes scandinaves, situé à mi-chemin entre Bergen et Oslo.
A certains égards, le livre peut être considéré comme un guide à l’usage des débutants. Are Kalvø y consacre une bonne partie à ses expéditions dans les magasins spécialisés pour acquérir l’équipement approprié, ainsi qu’à ses premiers contacts surréalistes (et irrésistibles) avec le DNT (la fédération norvégienne de promotion de la randonnée pédestre), qui gère une grande partie des refuges montagnards. Sans avoir l’air d’y toucher, et toujours avec l’humour qui le caractérise, l’auteur distille de nombreux conseils pratiques, sur le marquage des sentiers de randonnée en Norvège ou sur le matériel adéquat (faire et refaire son sac à dos correctement, par exemple, est une activité récurrente et primordiale). Le lecteur étranger apprend aussi beaucoup sur le mode de vie et de pensée des Norvégiens, sur les régions touristiques les plus prisées, etc. L’auteur, nous fait découvrir, (certes, de manière un peu rocambolesques) de merveilleux paysages… sauf quand il pleut ou qu’il y a du brouillard, soit 90% du temps au cours de ses deux voyages.
En réalité, Are Kalvø, n’est pas totalement néophyte puisqu’il a grandi dans une ferme au pied d’une montagne. Son village natal, Stranda, c’est illustré en 1983 en accédant au troisième tour du championnat de football de Norvège et en battant Ålesund. Mais cela est une autre histoire même si le narrateur avoue être un supporter actif et enthousiaste. Ce qui nous intéresse ici, concerne plutôt ses compétences en marche à pied et en ski de fond. Or, contre toute attente, notre citadin d’adoption, peut s’enorgueillir de quelques connaissances en la matière. Dans sa région d’origine, en effet, les sorties scolaires se faisaient plus souvent à ski qu’en bus. De même, l’école organisait-elle moultes compétition de sauts à ski. Coté marche, il faut savoir que notre bon vivant est également adepte de longues promenades quotidiennes en milieu urbain. Si j’insiste autant sur ses compétences, c’est parce que j’ai été surprise par son endurance au cours de ses fameuses randonnées en montagne.
Je dois reconnaître qu’il y a des passages franchement hilarants. Are Kalvø adore se jouer des préjugés. Il est également adepte de l’auto-dérision et du comique de répétition. L’un de ses ingrédients est d’ailleurs nécessaire pour aborder cet ouvrage, surtout si vous êtes un randonneur et/ou un sportif convaincu. Certaines situations auront sans doute le goût du vécu mais il y a des moments où l’humoriste norvégien n’y va pas avec le dos de la cuillère. Personnellement, il n’a pas réussi à me dégouter de la pratique du ski ou de la randonnée.
📌Randonnée en enfer. Are Kalvø. Glénat, 408 p. (2022)