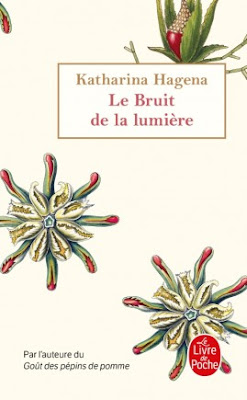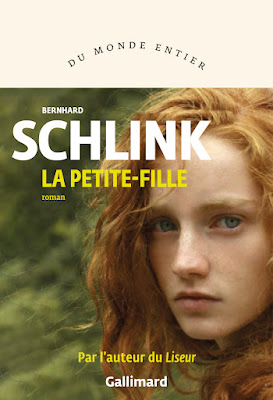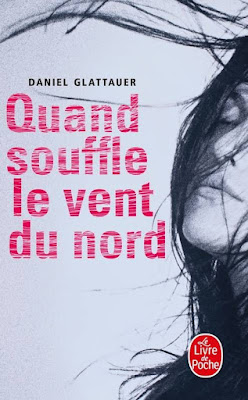« Je crois que je suis le veilleur de la nuit. Je n’ai rien d’autre à faire que déambuler dans ses rues comme un gardien attentif. Paris veut sa bouche. Elle a faim de mots. Trop de vies s’entassent en elle. Il faut les dire. C’est pour cela que l’homme m’a demandé de le suivre. Et maintenant, partout où je vais, des foules agitées se pressent devant moi. Comme si les rues en accouchaient. La jeunesse frappe le pavé. Les années se superposent. D’un siècle à l’autre, peu importe… Elles veulent toutes entrer en moi. Le passé est vorace de nos esprits parce qu’il n’y a que là qu’il puisse encore vivre. »
Ce texte n’est pas un roman mais un récit, ou plutôt une flânerie dans les rues de la capitale. Un soir de juillet, le narrateur, alter ego de Laurent Gaudé, croise sur l’esplanade de la gare Montparnasse, un homme (un fou, un spectre ou un clochard céleste), qui l’interpelle : « Qui es-tu, toi ? ». Cette question est peut-être lancée à la cantonade et ne s’adresse pas directement à notre promeneur… ou peut-être que si justement. Quoi qu’il en soit, le narrateur juge qu’elle mérite une réponse. Le fil de ses pensées le conduit à se remémorer la disparition précoce de son père, victime d’une chute accidentelle et retrouvé mort en bas de son immeuble parisien. Les pavés qu’il foule sont autant de jalons marquant l’histoire personnelle de notre promeneur mais aussi de milliers d’autres avant lui, personnages illustres ou inconnus. Dans le quartier latin, près de la Sorbonne, Laurent Gaudé convoque le fantôme du poète François Villon (1431-1463). Arthur Rimbaud lui apparait à l’angle de la rue Racine et de la rue Ecole de médecine, au milieu du cercle des Zutistes, tandis qu’Antonin Artaud s’invite une dernière fois au théâtre du Vieux Colombier. Victor Hugo, lui, repose au Panthéon pour l’éternité. Aux côtés de ces gens de lettres qui ont participé au rayonnement de la ville des lumières, il faut aussi convoquer les figures héroïques, résistants et martyrs, qui ont combattu pour sa liberté… mille vies !
Paris, mille vies est un opus à la fois très personnel et riche de l’histoire collective. Il invite à la méditation par les sujets qu’il aborde mais aussi par la beauté du texte, empreint d’une grande nostalgie poétique. La ballade s’achève, du côté du carrefour de l’Observatoire, sur une note d’espoir avec une citation de Charles-Ferdinand Ramuz, tirée d’Adieu à beaucoup de personnages.
💪Cette lecture, clôt pour moi, la seconde édition du Challenge "Sous les pavés, les pages", organisé par Ingannmic et Athalie.
📌Paris, mille vies. Laurent Gaudé. Actes Sud Babel, 96 pages (2023)