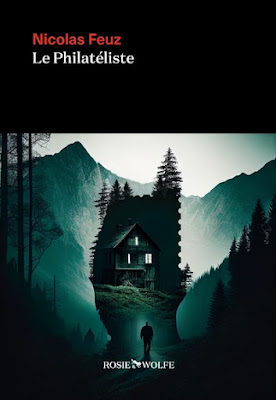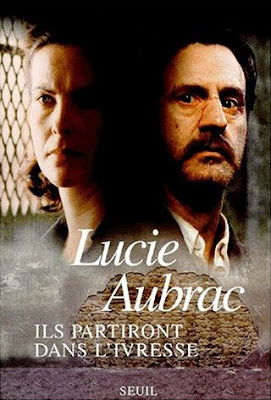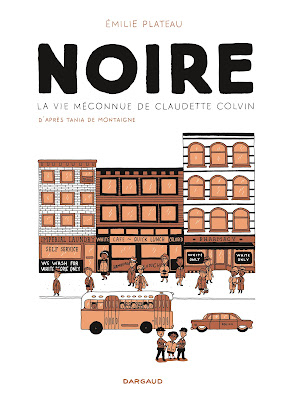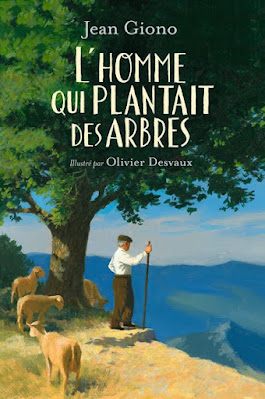Voici un cosy mystery australien très british. En effet, l’intrigue de ce whodunit utilise des éléments des romans d’Agatha Christie et en particulier des enquêtes de l’incontournable Hercule Poirot. Alicia Finlay, éditrice trentenaire, vit dans le quartier de Woolloomooloo (j’adore le nom) à Sydney. Elle vient de claquer la porte de son club de lecture qu’elle jugeait trop guindé. Lynette, sa sœur cadette, une maestria des fourneaux, lui suggère de créer un groupe qui lui corresponde mieux. C’est ainsi que nait le Murder Mystery Book Club (l’Agatha Christie Book Club dans la première version du roman). Les membres sont recrutés à l’ancienne (pour faire honneur à la figure tutélaire de la reine du crime britannique) via une annonce dans le journal et une lettre de candidature. A la fin du processus de sélection, il ne reste que 7 personnes en comptant les deux fondatrices. Outre Alicia et Lynette, le groupe est composé de Claire, gérante d’une boutique de vêtements de seconde main, Missy la bibliothécaire, Anders le séduisant médecin, Perry l’homosexuel extraverti et Barbara la femme au foyer dépressive. Celle-ci insiste pour recevoir la première réunion officielle du groupe à son domicile. A cette occasion, les membres du club de lecture vont s’apercevoir que la vie de famille de Barbara Parlour est loin d’être idéale. Son mari est un goujat et sa fille est en pleine rébellion adolescente. Lorsque Barbara disparait, ses nouveaux amis se transforment en détectives amateurs. Ils vont découvrir que la quinquagénaire a semé quelques indices derrière elle. Pour résoudre l’énigme, ils devront retourner aux sources, c’est-à-dire chercher la clé du mystère dans l’œuvre d’Agatha Christie.
The Murder Mystery Book Club est le premier volet d’une série policière qui compte six volumes à ce jour. Les deux premiers titres ont été traduits en français et sont publiés par les éditions du Cherche Midi : Ils étaient sept (Le Cherche Midi, 2023) et Le Crime du SS Orient (Le Cherche Midi, 2023). Les références à Agatha Christie tiennent plus du clin d’œil que de la connaissance approfondie de son œuvre et de sa biographie. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir lu l’intégrale des aventures du fameux détective belge à moustache pour faire fonctionner ses petites cellules grises et résoudre le mystère… ou plutôt les mystères car il faut bien qu’un crime de sang soit commis. Les amateurs de Cosy Mysteries retrouveront la plupart des ingrédients qui font le succès du genre donc rien de traumatisant. Bien que C.A. Larmer entretienne une ambiance délicieusement désuète dans son roman, l’histoire s’inscrit résolument dans l’air du temps (on peut boire du thé au coin de la cheminée et faire des recherches sur Internet). Les personnages sont attachants et je ne suis pas contre l’idée de les voir évoluer dans les prochains épisodes de la série. L’énigme n’est pas très compliquée à résoudre mais je dois reconnaître qu’elle est ingénieusement construite.
📚Je vous recommande d'aller voir l'avis de Fanja sur ce roman
📌The Murder Mystery Book Club. C.A. Larmer. Larmer Media, 284 pages (2021)