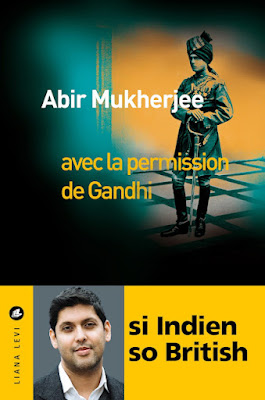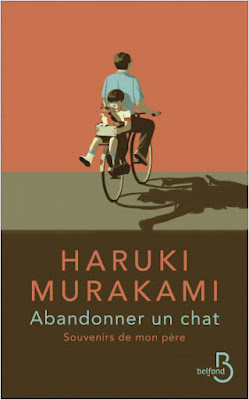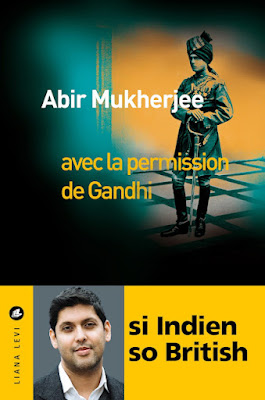
Au risque de vous décevoir, sachez qu’on ne croisera pas le Mahatma Gandhi dans ce roman mais plusieurs de ses disciples aux prises avec le colonisateur britannique. Nous sommes en décembre 1921 et Calcutta s’apprête à recevoir le Prince de Galles. La police impériale est sur les charbons ardents et les partisans du satyāgraha (la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse) compte bien profiter de l’occasion. Si l'ahiṃsā (non-violence) est la seule arme des manifestants, les autorités craignent néanmoins des débordements. Or, c’est dans ce contexte que survient une série de meurtres particulièrement violents. Le capitaine de police opiomane, Sam Wyndham, et son sergent, l’enquêteur d’origine bengalie, Sat Banerjee, se lancent donc à la poursuite de ce dangereux meurtrier qui pourrait bien déstabiliser le Raj britannique en cette période troublée. Leur enquête va rapidement établir que l’origine de ses crimes sanglants a un rapport avec la Grande Guerre. Sans vous donner la clé de l’intrigue, je peux néanmoins vous proposer un petit indice : le titre original du roman est Smoke And Ashes (fumée et cendres).
Avec la permission de Gandhi est le troisième volet des enquêtes du duo improbable Wyndham & Banerjee. La série compte à ce jour 5 épisodes dont 3 traduits en français. A chaque livre correspond une nouvelle année dans la chronologie qui doit conduire l’Inde vers l’indépendance :
- 1919 : A Rising Man (L’attaque du Calcutta-Darjeeling)
- 1920 : A Necessary Evil (Les princes de Sambalpur)
- 1921 : Smoke and Ashes (Avec la permission de Gandhi)
- 1922 : Death in the East (Le Soleil rouge de l'Assam)
- 1923 : The Shadows of Men
Le titre du premier volume s’inspire d’un poème de Rudyard Kipling intitulé City of Dreadful Night et paru dans Gazette Civile et Militaire en 1885. Abir Mukherjee aurait pu tout aussi bien choisir d’emprunter ses lignes à The White Man's Burden (Le Fardeau de l'homme blanc), le poème emblématique du chantre de l'impérialisme britannique. Au-delà de la figure complexe du prix Nobel britannique (qu’il convient sans doute de replacer dans le contexte de son époque), le projet d’Abir Mukherjee, à travers sa série policière, est d’explorer cette période charnière qui précède l’indépendance du Pays d’origine de ses ancêtres. S’il a choisi la cité historique de Calcutta (renommée Kolkata en 2001) pour étayer son propos, ce n’est pas un hasard. C’est la ville natale d’un autre prix Nobel de littérature (un Indien cette fois) : Rabindranath Tagore (1861-1941). C’est aussi celle du physicien Satyendranath Bose (1894 -1974). Calcutta, nous dit Abir Mukherjee, est une cité dont l’histoire est unique. Fondée au 17ème par La Compagnie anglaise des Indes orientales, pour consolider ses activités commerciales dans le Bengale, elle devient le siège des Indes britanniques puis la capitale du Raj entre 1773 et 1911. Elle cède ensuite son statut à New Delhi. Quoi qu’il en soit, au tournant du 19ème et du 20ème siècle, Calcutta est une ville cosmopolite et dynamique. Le premier bureau des empreintes digitales y est installé en 1897, soit 5 ans avant la branche de Scottland Yard… un territoire idéal donc pour les héros récurrents de notre romancier anglo-indien.
Contre toute attente, et en dépit de quelques tabous raciaux dont il a du mal à se dépêtrer, le capitaine Wyndham n’est pas un sale type imbu de lui-même. Bien au contraire, cet anti-héros est plutôt sympathique. En un sens, notre agent de police des forces impériales est un « has been » : ex enquêteur de Scotland Yard, vétéran de la première guerre mondiale, veuf éploré et opiomane acharné. Il reste néanmoins un excellent enquêteur, plutôt cynique mais doté d’un humour tout britannique. Son jeune second, le sergent Surrender-Not (Surendranath) Banerjee alias Sat Banerjee, est un personnage tout aussi tourmenté. Issu d’une famille bengalie influente, il a fait ses études en Angleterre avant de retourner dans son pays natal. Il est l’un des premiers officiers d’origine indienne du Bureau de police de Calcutta. Sa position au sein des forces impériales est d’ailleurs assez difficile à tenir vis-à-vis de ses proches et de ses concitoyens. Contrairement à son patron, le sergent Banerjee est un idéaliste qui souhaite protéger son peuple des débordements meurtriers qui feront sans doute suite au départ des colonisateurs. Il est persuadé, que le moment venu, les Indiens auront besoin d’hommes compétents pour maintenir la sécurité. Son pire ennemi est certainement sa timidité. Ce petit défaut lui joue de nombreux tours dans sa vie personnelle (notamment avec les femmes) mais aussi professionnelle. Le capitaine Wyndham, ne reconnait-il pas lui-même qu’il a tendance à sous-évaluer son subordonné ?
Vous l’aurez compris, le roman d’Abir Mukherjee n’est pas une simple série policière. L’intrigue, si elle est parfaitement bien menée (et que le suspense est au Rendez-vous pour les amateurs du genre), reste un prétexte pour aborder ce qui lui tient tellement à cœur. Attention, il ne s’agit pas pour autant d’un règlement de compte avec l’histoire (il y a trop d’humour et d’empathie dans ce texte pour cela) mais plutôt d’une mise au point sans concession.
La série Wyndham / Banerjee a été récompensée par de nombreux prix littéraires. Ce troisième volet, paru dans les pays anglophones en 2018, a reçu l’Historical Dagger Award (décerné par la Crime Writers' Association) en 2019 et le Prix Edgar-Allan-Poe du meilleur roman (organisé par l’association Mystery Writers of America) en 2020. Le livre, qui vient seulement d’être publié en France, a déjà reçu un accueil très positif dans les médias.
A noter enfin (pour ceux qui lisent l’anglais) qu’Abir Mukherjee a publié, en novembre dernier, un article passionnant dans The Guardian où il propose une liste de 10 ouvrages consacrés à Calcutta. La sélection mentionne notamment : La cité de la joie de Dominique Lapierre, Râga d'après-midi d’Amit Chaudhuri, La vie des autres de Neel Mukherjee ou Un nom pour un autre de Jhumpa Lahiri.
Extrait :
« Un cadavre dans un funérarium n’a rien d’inhabituel. Il est rare en revanche d’en voir un y entrer par ses propres moyens. Cette énigme mérite d’être savourée, mais le temps me manque, attendu que je suis en train de courir pour sauver ma peau. Un coup de feu retentit et une balle passe près de moi sans rien atteindre de plus menaçant que du linge qui sèche sur un toit. Mes poursuivants – des collègues de la Force de Police impériale – tirent à l’aveugle dans la nuit. Cela ne veut pas dire qu’ils ne pourraient pas avoir plus de chance avec leur prochaine rafale, et même si je n’ai pas peur de la mort, atteint d’une balle dans le dos en tentant de s’enfuir n’est pas exactement l’épitaphe que je souhaite sur ma tombe. »
📌Avec la permission de Gandhi. Abir Mukherjee. Liana Levi, 320 p. (2022)